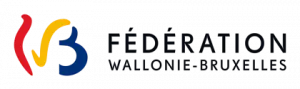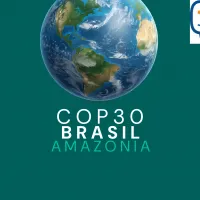Interview de Paul De Theux
- 55 vues

Retour sur 4 années de présidence du CSEM

A l’occasion de la fin du mandat de notre Président, Paul De Theux, également ancien directeur du Centre de ressources Média Animation, nous avons souhaité revenir avec lui sur les moments marquants de cette législature et les priorités du futur Conseil.
- Vous avez été Président du CSEM pendant 4 ans, que retiendrez-vous de cette Présidence ?
L'élément qui a été le plus marquant pour moi lors de cette présidence, c'est la mise en place du Plan éducation aux médias du Gouvernement, ce qui n’était jamais arrivé depuis la naissance du Conseil ! Ce Plan a démontré une volonté politique de renforcer l'éducation aux médias. Il comportait 62 actions à mettre en œuvre, ce qui est évidemment considérable. Elles ne se sont pas toutes concrétisées parce que c'était assez ambitieux, mais ce qui est important, c'est qu’il y a eu à la fois une volonté politique et la mise en œuvre de toute une série de nouvelles initiatives et projets qui ont permis de déployer, de renforcer, de soutenir l'éducation aux médias.
Les 3 actions principales que je retiens du Plan c'est la « Semaine de l'éducation aux médias » qui a lieu chaque année et qui propose des centaines d'activités dans les écoles et les organisations de jeunesse. Ces activités touchent un large public et ont rencontré un vif succès.
Je pense aussi aux nouveaux « Appels à projets de production, d'outils, de ressources et de contenus d'éducation aux médias » où une série d'acteurs ont pu faire émerger des choses importantes.
Enfin, la mise en place d’une journée annuelle des « Rencontres des professionnels » du secteur qui réunit tous ceux qui s'intéressent à l’EAM et qui ont une expertise dans le domaine. Le fait de partager, d’échanger a permis d'élargir le tissu de l'éducation aux médias et de toucher une série d'acteurs qui souhaitent faire de l'éducation aux médias en leur transmettant une véritable expertise.
Il y a aussi d'autres actions mais je trouve que celles-là sont des nouvelles initiatives qui vont s'inscrire dans la durée et qui sont de véritables apports et progrès au niveau de la politique d’éducation aux médias en Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Y a-t-il d’autres dossier ou projets au sein du Conseil qui ont marqué cette période ?
J'ajouterais le fait que le Conseil a été invité à repérer dans les référentiels de l'enseignement les endroits où on retrouve de l'éducation médias sans que ce soit explicitement présenté comme tel. Ça a été un très gros travail réalisé par le Conseil qui a permis de pointer tous les endroits où l'éducation aux médias est activée dans les programmes de l'enseignement. Ce travail, regroupé dans un document synthétique, permet aux enseignants de bien identifier ce qu'ils sont invités à faire sous le label « éducation aux médias » parce que finalement, la limite de ces référentiels, c'est qu’ils induisent une série d'actions mais sans les présenter comme étant de l'éducation médias. Il s’agit donc d’un travail important et utile qui a été réalisé.
Et puis, je pense aussi à un autre gros chantier du Conseil, c'est la préparation du nouveau décret puisque le décret actuel datait de 2008. Le monde des médias a beaucoup évolué depuis, il fallait donc adapter les choses, il fallait le mettre à jour et cela a été un gros travail qui a été réalisé bien sûr par le pouvoir politique mais dans lequel le Conseil a pris sa part et a ajouté sa pierre à l'édifice.
Est-ce que les enjeux de l’éducation aux médias ont évolué en 4 ans ?
L'éducation aux médias s'est imposée ces dernières années comme étant de plus en plus vitale et primordiale dans notre société. Je dirais qu’il y a deux grandes thématiques qui sont connues mais qui méritent d'être soulignées.
Tout d’abord, il y a évidemment la désinformation, qui a été en quelque sorte précédée par les théories du complot, et qui est de plus en plus considérée comme un enjeu majeur. Si on veut que le secteur éducatif et le secteur associatif puissent s'emparer de cette thématique, il est nécessaire de proposer des outils qui permettent concrètement d’apprendre comment la décoder, en faire l'analyse et la qualifier, et non simplement de la dénoncer. Donc cette problématique de la désinformation a été et reste un des gros chantiers actuels de l'éducation aux médias.
Le deuxième grand enjeu de l’EAM que je citerai, ce sont les intelligences artificielles qui ont émergé il y a 2, 3 ans et qui sont pour la plupart d'entre nous quelque chose de très nouveau que l’on ne connaît pas très bien.
La plupart des gens ne savent pas comment cela fonctionne, comment ça se fait qu’un ordinateur nous réponde sur des questions assez pointues… et donc mieux connaître les IA, comprendre comment elles fonctionnent, voir quelle place leur donner, quelles sont leurs limites et à quoi il faut être attentif dans les usages qu'on en fait, c'est certainement une des questions qui continuera à être travaillée ces prochaines années.
Enfin, il y a tout ce qui touche aux réseaux sociaux qui ont une place importante dans la société (avec toutes les questions que cela soulève) et qui doivent être aussi abordées pour permettre de les utiliser dans les meilleures conditions possibles.
- Quelles sont, selon vous, les priorités du prochain Conseil ?
Même si cela va dans le bon sens, la difficulté de l'éducation médias, c'est qu'elle reste encore trop méconnue et pas suffisamment diffusée. Il reste encore énormément de travail à faire, notamment en termes de propositions de ressources pour le monde éducatif au sens large (enseignement mais aussi la formation des adultes). Il est important que des outils soient développés, mis à jour et diffusés auprès de ceux qui font ce travail éducatif, mais aussi qu’ils puissent être accessibles au plus grand nombre.
Je pense aussi au fait que le nouveau décret prévoit la possibilité de créer de nouveaux centres de ressources. Aujourd’hui, les centres de ressources visent le monde de l'enseignement, il y a donc une possibilité de créer des centres de ressources qui pourraient s’adresser à d’autres publics comme la jeunesse, les adultes, les parents mais aussi d'autres secteurs plus minorisés comme les seniors, les primo-arrivants, etc.
Si le décret prévoit la reconnaissance de nouveaux centres de ressources, il ne prévoit en revanche pas de financement pour les mettre réellement en activité. Il y a donc là un véritable enjeu pour le prochain Conseil !